3- Organisation politique du Soudan Français en régions et cercles ou résidences, relations avec les colonies voisines
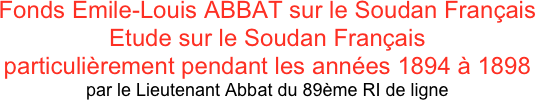



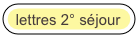



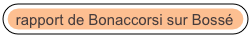



Le Soudan Français est subdivisé en un certain nombre de Régions à la tête desquelles est placé un chef de Bataillon ou d'escadron Commandant de Région.
Chaque région est subdivisée elle-même en un certain nombre de cercles administrés soit par des fonctionnaires civils (en très petit nombre, deux je crois) soit par des officiers appartenant à l'État Major du Soudan ou, à défaut, aux troupes.
Certaines contrées où l’administration directe n’a pas encore été introduite sont érigées en résidences.
Afin de donner une idée du fonctionnement de ces différents commandements, je ne saurais mieux faire que d’exposer les occupations des officiers dans les régions, cercles et résidences où j’ai été appelé à servir durant mon séjour au Soudan. Je prends comme exemple la région du Sahel, le cercle de Sokolo et la résidence du Mossi.
Le chef de bataillon commandant la région du Sahel habitait Nioro (sa résidence a du être transportée à Goumbou, plus au centre de son commandement). Il a sous ses ordres les commandants des cercles de Goumbou, Nioro et Sokolo. Il commande à toutes les forces militaires stationnées dans la région. On lui donne ainsi les moyens d’assurer la garde de cette région. Le commandant de la région a seul le droit de communiquer directement, sauf le cas de force majeur, avec le Gouverneur. Il se tient au courant de la politique des cercles et dirige cette politique.
Aux commandants de cercles incombent d’autres devoirs. A Sokolo par exemple, où je fus successivement adjoint au commandant du cercle puis commandant du cercle, notre premier devoir était d’assurer la police dans l’intérieur du cercle. Pour cela, une compagnie d'infanterie (tirailleurs soudanais) et une section d’artillerie étaient stationnées sur notre territoire et pouvaient être requises par nous selon les besoins. Nous devions nous tenir au courant de ce qui se passait sur nos frontières et rendre compte chaque mois de l’état politique du cercle. Nous devions nous tenir en relations avec les régions et cercles voisins et coopérer au besoin à leurs mouvements. C’est en raison de ces prescriptions que nous installâmes en 1896 le poste de Nampala, transporté plus tard à Léré pour appuyer le mouvement que la région nord (Tombouctou) venait de dessiner sur Bassikounou (*actuelle) en créant le poste de Râs-el-Mâ à l’extrémité ouest du lac Faguibine. Nous étions chargés de la perception des droits de douane et de l’installation des postes de douane là où il nous semblait utile d’en placer. Nous devions surveiller les routes, en assurer le bon entretien, en créer de nouvelles, faire le recensement de la population et des richesses du pays, établir le rôle d’impôts et en assurer la rentrée. Dans le chef-lieu du cercle et dans les autres localités si nous le jugions nécessaire, nous devions aménager des marchés couverts et nous efforcer par tous les moyens possibles de développer les transactions. Dans l’intérieur du poste, le commandant du cercle devait s’occuper d’améliorer le sort matériel des Européens qui l’habitaient, élever des bâtiments, créer une école, rendre la justice en dernier ressort. Le commandant du cercle était comptable de tout le matériel et de toutes les denrées mises à la disposition pour assurer la nourriture et l’entretien des militaires et agents stationnés sur son territoire. Enfin, chaque officier résidant dans le cercle était tenu de lever un minimum de 100 kilomètres de routes par mois, de façon à pouvoir ainsi établir peu à peu une carte aussi complète que possible du territoire placé sous l’autorité du commandant de cercle.
Pour mener à bien une tâche aussi lourde, chaque commandant de cercle a à sa disposition un ou plusieurs officiers adjoints, des interprètes, des secrétaires, des gardes-magasins, des manœuvres, un boulanger, un jardinier, un boucher, des bergers, etc.
Les officiers placés à la tête d’une résidence ont les mêmes devoirs que les commandants de cercle. La différence entre un cercle et une résidence consiste en ce qu’au lieu de commander directement aux populations, les résidents leur font parvenir leurs ordres par l’intermédiaire d’un chef indigène à qui l’on conserve son ancienne autorité, mais sous notre contrôle. Cette organisation d’un territoire en résidences n’est autre chose qu’un acheminement vers l’administration directe. Elle est en général nécessitée par l’intérêt que nous avons de ne pas amener trop brusquement les habitants à notre façon d’agir à leur égard, et surtout par l’intérêt qu’il y a souvent à maintenir à la tête des populations un chef respecté et aimé ou appartenant à une famille dont l’autorité est telle que de sa soumission ou de sa rébellion dépendent la pacification du pays ou la prolongation de l’état de guerre.
Dans l’intérieur des cercles, le territoire est subdivisé en un certain nombre de cantons ayant à leur tête un chef indigène pris dans l’une des grandes familles du pays. Ces cantons comprennent un certain nombre de villages ayant à leur tête un chef nommé à l’élection. Plus sages que nous en cette occasion, les noirs choisissent toujours comme chef de village l’un des plus vieux notables, lequel est en outre assisté d’un conseil presque exclusivement composé de barbes blanches. L’autorité de ce chef de village est presque omnipotente et personne ne songe à la battre en brèche. Cette soumission au chef de village est telle que l’on tend actuellement à supprimer dans chaque cercle les chefs de cantons. Ces personnages, en raison de leurs attaches de famille et de leur rapacité, suscitent souvent plus de difficultés qu’ils ne rendent de services.
Avant de parler de l’organisation administrative du Soudan Français, je crois devoir dire quelques mots des relations de voisinage que nous eûmes au Soudan pendant ces dernières années avec les anglais et les allemands.
A la suite de la signature du traité de Berlin en 1890, il fut convenu que chacune des colonies de la côte occidentale d’ Afrique disposerait d’un hinterland où pourrait s’exercer son influence et qui fut en principe limité de part et d’autre au 10° degré de latitude nord. Toutefois, le champ des explorations au delà n’était point limité, et il fut tacitement convenu que le pays appartiendrait à la puissance qui, la première, occuperait effectivement le territoire.
Après la remarquable campagne du Colonel Combes en 1893, la colonie anglaise de Sierra Leone était complètement coupée de son hinterland et l’accès du Niger lui était interdit.
C’est à partir de ce moment que le gouvernement anglais, craignant le même sort pour ses colonies de Côte d’ Or et de Lagos, lançait en avant le Métis Ferguson et décorait du nom prétentieux de ministres plénipotentiaires de la Reine les commerçants noirs qui poussaient jusqu’à Lokoja (*Nigeria actuel) sur le Niger. Les Allemands de leur côté lançaient le Lieutenant Von Carnap dans l’arrière-pays du Togo avec Say comme objectif.
Ce fut alors entre nos explorateurs, les anglais et les allemands une véritable course au clocher qui n’eut d’ailleurs d’autre résultat que de faire connaître, assez mal, les territoires parcourus.
Les contestations qui s’élevèrent au retour des explorateurs menaçaient de durer indéfiniment, chacun d’eux se vantant d’être arrivé bon premier et rapportant des liasses de traités qu’ils prétendaient avoir fait signer aux seuls monarques légitimes.
On prit en France le bon parti, celui de mettre nos voisins en présence du fait accompli et d’occuper effectivement le pays comme prescrivait le traité de Berlin. C‘est en exécution de cette décision que fut organisée la remarquable poussée en avant qui en 1896, 1897 et 1898 devait amener la fonction de nos colonies du Soudan, du Dahomey et de la Côte d’ Ivoire, et isoler complètement les colonies voisines.
Cette marche en avant ne s’accomplit pas sans protestations de la part de nos voisins et sans qu’ils cherchassent à nous susciter des difficultés. Au Mossi, au Gouroundi et au Gourma, les objectifs des deux partis se trouvèrent rapidement en présence, mais les officiers qui les commandaient eurent toujours le bon esprit et la sagacité de dissimuler leurs convoitises et de déguiser leurs revendications sous une urbanité et une politesse qui firent croire aux indigènes que les blancs étaient toujours d’accord quelle que fut leur nationalité. En présence de l’ennemi commun, les rivalités de race s’effacèrent et les relations furent toujours empreintes, devant les noirs, de la plus grande cordialité.
Néanmoins un ordre de Paris faillit tout gâter. En janvier 1898 les officiers qui se trouvaient en contact avec les Anglais reçurent directement du ministère l’ordre suivant: "Défendre nos droits avec le plus d’âpreté possible, mais au cas où les Anglais se laisseraient aller à engager un conflit, supporter leur feu et se retirer sans riposter". Au reçu d’un pareil ordre, la stupéfaction fut grande et plusieurs officiers refusèrent de prendre un pareil engagement. Les protestations énergiques du Colonel Audéaud, alors Gouverneur du Soudan, firent bientôt rapporter cet ordre. Il est bon d’ajouter que les Anglais ayant de leur côté reçu un ordre analogue, aucun conflit n’était à craindre. Mais nous ne sûmes ce détail que beaucoup plus tard.
Cet incident nous montra combien il était nécessaire de conserver notre sang-froid en présence des événements et combien nous avions été sages d’apporter autant de circonspection dans nos relations de voisinage.
Heureusement, la convention du 14 Juin 1898 vint remettre les choses au point et apporta une détente nécessaire à l’état d’esprit des officiers en présence. A l’heure actuelle, les chefs des postes frontières s’ingénient par tous les moyens à aplanir les difficultés de façon à ne pas donner aux indigènes le spectacle de rivalités semblables à celles qui séparent si souvent leurs gouvernants indigènes.
mardi 11 avril 1899