4- Organisation administrative
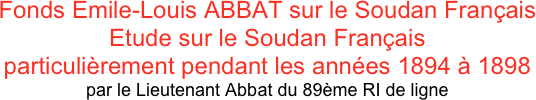



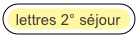



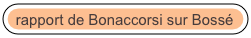



Pour l'administration, le Soudan Français relève du Gouvernement Général de l’ Afrique Occidentale institué par décret du 19 Juin 1895.
Dans l’intérieur de la colonie, le service administratif est placé sous la haute direction d’un fonctionnaire du commissariat de la marine dont les fonctions sont sensiblement analogues à celles d’un intendant dans un corps d’armée.
Toutefois, le gérance du budget local est en dehors de ses attributions. Ce budget est absolument entre les mains du Gouverneur.
Au Soudan comme dans toutes les autres colonies, les ressources mises à la disposition du Gouverneur sont de deux sortes : celles fournies par la métropole à titre de secours provisoires et dénommées "budget colonial", et celles provenant de la colonie elle–même et constituant le "budget local".
A ces deux budgets incombent différentes charges. La tâche d’un gouverneur doit être d’augmenter les ressources du budget local de façon à diminuer puis à supprimer l’appoint fourni par la métropole, afin d’arriver, dans le plus bref délai possible, à rembourser à cette métropole les avances qu’elle a faites.
Malheureusement ces desiderata sont bien rarement atteints. Parce qu’au fur et à mesure que les ressources locales d’une colonie augmentent, on se croit, en France, obligé d’augmenter aussi les charges de cette colonie, en la dotant de tous les rouages de cette remarquable administration française qui n’a que le très grand défaut d’être ruineuse.
Quoiqu’il en soit, au Soudan, le budget colonial subvient aux dépenses nécessitées par l’entretien des troupes. C’est une assez lourde charge imposée à la métropole mais qui ne peut pas encore être supportée par la colonie, bien que depuis quelques années le budget local ait augmenté dans de très notables proportions.
Au budget local incombent déjà toutes les dépenses nécessitées par l'organisation politique du pays (régions, cercles, résidences), par la construction du chemin de fer et du télégraphe, par la création et l’entretien des routes, etc. Or il faut songer que nous n’avons pu, du jour au lendemain, frapper d’un impôt trop lourd des populations habituées à payer une très légère dîme en nature ou même rien du tout, et surtout il ne faut pas oublier que le Soudan ne fournissant que très peu de numéraire, la plupart des impositions sont fournies en nature d’où une grosse difficulté pour l’écoulement de toutes en denrées et marchandises.
Les ressources du budget local sont de deux sortes: celles provenant de l’impôt, celles provenant des droits de douane.
L’impôt au Soudan est réparti village, selon la population approximative de ce dernier et selon sa richesse (je dis population approximative car l’état civil n’existait pas encore pour les indigènes, il est presque impossible de connaître exactement le chiffre de la population d’une localité). L’impôt est fixé par tête et il est en moyenne de 1.50 francs par habitant.
Le rôle de l’impôt, établi chaque année par le commandant du cercle, est communiqué en séance publique aux chefs de village, après approbation du Gouverneur.
Le chef de village est chargé de la répartition entre les chefs de case (chef de famille en général) de son village. C’est lui qui apporte ensuite au chef-lieu du cercle le montant de l’impôt. Un reçu extrait d’un carnet à souche, lui est délivré séance tenante et certifie de la libération du village.
Cette manière de faire a certes de nombreux inconvénients dont l’un des principaux est certainement d’ouvrir la porte aux exactions de chefs de village peu scrupuleux, mais outre qu’il n’est guère possible de faire autrement, l’honnêteté des chefs de village est en général suffisamment grande pour que l’exemple d’un concussionnaire soit une rareté. Du reste, il est bon de dire qu’afin d’enrayer dès le début les tentations de ce genre, des peines sévères ont été jusqu’ici appliquées aux chefs de village d’une honnêteté trop élastique.
Dans quelques centres importants, tels que Kayes, Kita, Bamako, Ségou, Kioro, l’impôt cesse d’être collectif, et le recensement de ces points ayant été scrupuleusement fait, cet impôt est acquitté directement entre les mains du commandant de cercle par chaque chef de case, et depuis déjà trois ans il est exigé tout entier en numéraire.
Ailleurs, une partie seulement de l’impôt et la plus faible est exigée en numéraire ; le reste est acquitté en nature, soit en céréales, soit en bestiaux, lesquels sont alors cédés, contre remboursement, au budget colonial et servent à la nourriture des troupes.
Les chevaux reçus au titre de l’impôt sont vendus aux enchères ou cédés aux escadrons de spahis ou à l’artillerie.
Les droits de douane sont de deux sortes : ceux qui s’appliquent aux marchandises de provenance européenne et pour lesquelles des tarifs spéciaux sont édictés, ceux s’appliquant aux importations et exportations indigènes pour lesquelles un droit fixe du 1/10° est perçu sur la quantité. Ce droit du 1/10° est ce qu’on appelle au Soudan l'oussourou. Il existait avant notre arrivée, nous l’avons maintenu.
Afin de satisfaire à la fois les intérêts de la colonie et des commerçants, ce sont les commandants de cercle ou leurs agents qui choisissent l’oussourou à prélever sur les caravanes.
Le droit d’oussourou peut être acquitté en argent. On se base alors sur les prix des mercuriales établis chaque année. Les marchandises provenant de l’oussourou sont écoulées au profit du budget local par les mêmes moyens que celles provenant de l’impôt (ventes aux enchères ou cession).
Aux commandants de cercle incombent la gérance des magasins du service local.
Toutes les sommes d’argent reçues par les commandants de cercle sont aussitôt versées entre les mains des agents du Trésor là où il existe des fonctionnaires de ce service, et dans les caisses des agences spéciales là où il n’existe point de trésorier-payeur.
Ces agences spéciales, véritables succursales des caisses de la trésorerie, sont gérées par des officiers désignés à cet effet. Leur encaisse varie de 60 000 à 100 000 francs.
Elles sont chargées d’acquitter toutes les dépenses et d’effectuer toutes les recettes dans l’étendue de leur circonscription. Elles ne peuvent cependant effectuer le paiement de la solde proprement dite aux officiers européens. Il leur est également interdit de délivrer des mandats.
Ces opérations sont absolument réservées aux agents du Trésor et encore le paiement de la solde aux officiers européens est-il subordonné à l’ordonnancement préalable d’un fonctionnaire du commissariat.
C’est une chinoiserie administrative qui ne s’explique guère, mais qui eut pour effet pendant toute l’année 1895 de priver de leur solde les officiers de Tombouctou, parce que dans cette ville, par suite des hasards de l’existence coloniale, le fonctionnaire du commissariat ordonnateur des dépenses et l’agent du Trésor chargé de les acquitter n’y séjournèrent point en même temps. Et il y avait dans la place trois agences spéciales!
A son arrivée au Soudan, chaque officier ou chaque homme de troupe détaché reçoit un livret de solde sur lequel sont mentionnées au fur et à mesure qu’il les perçoit, toutes les sommes qu’il reçoit pour son propre compte. Lors du passage à Kayes au moment du retour en France, les écritures du livret de solde sont régularisées.
Cette régularisation est grandement simplifiée par ce fait qu’au Soudan il n’existe, en dehors de la solde proprement dite, que deux sortes d’indemnités : l’indemnité de séjour (4 francs pour les Sous-lieutenants, 6 pour les Lieutenants et Capitaines, 10 pour les officiers supérieurs) due pour toute journée de présence au Soudan, et les indemnités de fonctions (Commandant de région, de cercle, résidents, agents spéciaux, etc.) due pendant le temps qu’a duré la fonction.
mardi 11 avril 1899